3.3.3.1. Fonctionnement d'un filtre ŕ sable rapide
Un filtre à sable rapide est peu efficace lorsqu'il doit traiter une eau n'ayant pas bénéficié d'une coagulation et d'une floculation. Un tel filtre élimine en effet difficilement les particules non absorbées par le floc, et ce même s'il est constitué d'une épaisse couche de sable fin.
Le floc contenu dans l'eau doit par ailleurs résister aux forces de cisaillement qui s'exercent dans le filtre, faute de quoi il se brise et pénètre plus profondément dans le milieu filtrant. En plus de la résistance du floc, les facteurs suivants peuvent affecter la qualité de l'eau filtrée :
- caractéristiques granulométriques du milieu filtrant;
- porosité du milieu filtrant;
- épaisseur du milieu filtrant;
- charge superficielle.
Des essais effectués sur un milieu filtrant constitué d'une couche de sable de 60 cm d'épaisseur (diamètre effectif de 0,5 mm; porosité: 42 %) ont permis de comparer la résistance de plusieurs flocs. La charge superficielle était de 4,9 m/h.
Voici les principaux résultats.
- Floc très faible : Augmentation importante de la turbidité lorsque la perte de charge est inférieure à 0,6 m.
- Floc faible : Augmentation de la turbidité lorsque la perte de charge varie entre 0,6 et 2,4 m.
- Floc moyen : Le floc pénètre dans le filtre sur une profondeur de plus de 7 ,5 cm, sans augmentation de la turbidité de l'eau filtrée.
- Floc fort : Le floc pénètre dans le filtre sur une profondeur de moins de 7,5 cm.
Le diamètre des particules de floc qui arrivent sur un filtre varie de 0,1 à 2 mm. La grosseur des interstices dans un milieu filtrant constitué de sable (diamètre effectif: 0,5 mm) varie de 0,1 à 0,2 mm. Les grosses particules de floc sont donc arrêtées à la surface du filtre, tandis que les particules plus petites pénètrent dans le filtre avant d'être arrêtées. Sauf lorsque le floc est exceptionnellement fort, les grosses particules sont brisées sous l'action des forces de cisaillement; il est donc inutile d'essayer de ne pas briser le floc dans les eaux décantées. En fait, la plupart des particules de floc sont arrêtées dans les 10 cm supérieurs du filtre.
3.3.3.2. Variation de la turbidité et des pertes de charge
La turbidité de l'effluent d'un filtre et la perte de charge à travers le filtre sont les deux facteurs qui permettent de contrôler le fonctionnement d'un filtre. Ainsi, lorsque la perte de charge atteint une valeur de consigne prédéterminée ou que la turbidité de l'effluent du filtre dépasse une certaine valeur, on isole le filtre en question et on procède à un lavage. La période d'utilisation d'un filtre correspond donc à la durée de son utilisation entre deux lavages.
1- Variation de la turbidité
Dans le traitement qui permet de réduire la turbidité, la filtration est habituellement la dernière étape. L'effluent du filtre doit donc satisfaire aux normes sur l'eau potable. Rappelons que la turbidité de l'eau ne doit pas dépasser 5 unités de turbidité néphélométrique et que, dans plusieurs régions, l'objectif à atteindre est une turbidité inférieure à 1 unité néphélométrique.
La variation de la turbidité de l'effluent du filtre en fonction du temps est en général représentée par une courbe semblable à celle de la Figure 3. 3. Au début de la période d'utilisation du filtre, la turbidité, relativement élevée, diminue rapidement pour atteindre un plateau. Ce plateau, maintenu pendant plusieurs heures, est suivi d'un accroissement rapide de la turbidité. Lorsque la turbidité de l'effluent est de 1 unité néphélométrique, on lave le filtre. On peut expliquer la valeur importante de la turbidité au début du cycle de filtration de la façon suivante: au début, les petites particules de floc traversent facilement le filtre; après une certaine période d'utilisation, les particules de floc arrêtées par le filtre adsorbent les particules fines.
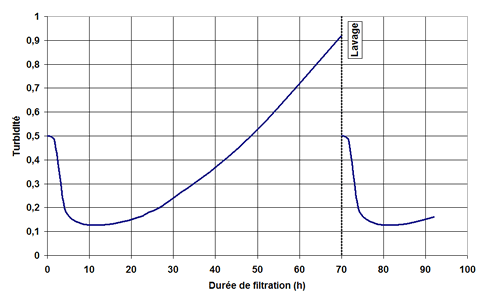
Figure 3. 3 : Variation de la Turbidité en fonction du temps
Le niveau du plateau et la durée de la période d'utilisation du filtre en fonction de la turbidité de l'effluent dépendent des facteurs décrits ci-dessous.
- Faible résistance du floc. La turbidité à la sortie du filtre est en moyenne plus élevée et la période d'utilisation plus courte.
- Décantation déficiente. La turbidité à rentrée du filtre est plus élevée et la période d'utilisation plus courte. Si le floc est très résistant, la turbidité de l'effluent du filtre demeure faible et les pertes de charge augmentent rapidement.
- Augmentation de la charge superficielle. La valeur des forces de cisaillement qui s'exercent sur le floc à l'intérieur du filtre augmente. Si le floc n'est pas très résistant, la turbidité est plus élevée dans l'effluent du filtre et la période d'utilisation est plus courte.
- Augmentation de l'épaisseur du milieu filtrant. La période d'utilisation du filtre est plus longue (on suppose que la valeur de la perte de charge demeure inférieure à la valeur de consigne).
- Remplacement d'une couche de sable par de l'anthracite (diamètre plus grand, densité plus faible). Le pourcentage des vides dans le filtre augmente et la période d'utilisation est plus longue.
2- Variation des pertes de charge
On peut facilement mesurer la perte de charge totale à travers un filtre à l'aide de deux conduites transparentes installées verticalement dans la galerie des filtres. Une conduite est reliée à l'affluent du filtre (si celui-ci est submergé) et l'autre, à l'effluent. La différence des niveaux de l'eau dans ces deux conduites correspond à la perte de charge.
La Figure 3. 4 illustre la variation des pertes de charge à l'intérieur d'un filtre en fonction de l'épaisseur du milieu filtrant et du temps de filtration. La valeur a correspond à la perte de charge initiale à travers l'ensemble du filtre, valeur qu'on peut calculer à l'aide des équations de Carman-Kozeny ou de Rose. La valeur c correspond à la perte de charge totale à travers l'ensemble du filtre après 10 h de filtration.
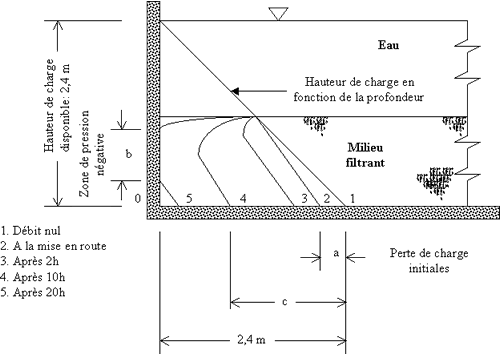
Figure 3. 4 : Variation des pertes de charge en fonction de l'épaisseur du milieu filtrant et du temps de filtration
En général, on limite les pertes de charge à travers un filtre rapide à une valeur maximale située entre 1,8 et 2,4 m, ce qui permet d'éviter la formation d'une zone de pression négative à l'intérieur du filtre. Une zone de pression négative est une zone dans laquelle la pression est inférieure à la pression atmosphérique (zone b de la Figure 3. 5). Dans les zones de pression négative, il y a formation de bulles d'air, ce qui réduit la surface filtrante et entraîne une augmentation de la vitesse d'écoulement dans le filtre et, par le fait même, une augmentation des pertes de charge; il y a donc risque de détérioration de la qualité de l'effluent.
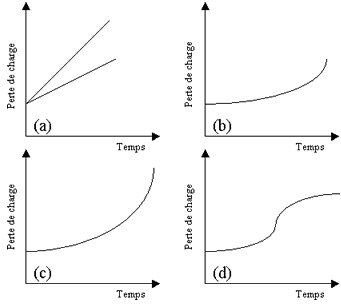
Figure 3. 5 : Variation des pertes de charge en fonction du temps
La variation des pertes de charge totales en fonction du temps de filtration fournit des indications sur le fonctionnement d'un filtre. Ainsi, des pertes de charge initiales plus élevées après plusieurs lavages révèlent que le filtre est probablement mal lavé ou que les drains et le gravier de support sont en train de se colmater. Le taux d'augmentation des pertes de charge en fonction du temps permet en outre de déceler plusieurs défauts de fonctionnement. Ainsi, pour une vitesse de filtration constante, on peut obtenir plusieurs types de courbes et en déduire les problèmes de fonctionnement du filtre (Figure 3. 5).
- Courbe droite (Figure 3. 5 a)
L'élimination des particules a lieu dans toute l'épaisseur du milieu filtrant. Dans ces conditions, une augmentation de la charge superficielle entraîne un accroissement de la perte de charge initiale et une augmentation plus rapide des pertes de charge; la période d'utilisation du filtre est alors plus courte.
- Courbe droite de pente plus élevée (Figure 3. 5 a)
Il y a augmentation de la turbidité dans l'affluent, et ce sans augmentation de la charge superficielle.
- Courbe avec une légère courbure vers le haut (Figure 3. 5 b)
L'élimination d'une partie des impuretés a lieu en profondeur.
- Courbe avec une forte courbure vers le haut (Figure 3. 5 c)
L'élimination des particules d'impuretés a surtout lieu à la surface du filtre. Dans ce cas, pour augmenter la durée de la période d'utilisation, on peut soit accroître la taille des grains du matériau filtrant à la surface du filtre (en remplaçant une couche de sable par une couche d'anthracite), soit accroître la charge superficielle afin d'augmenter la valeur des forces de cisaillement et de forcer ainsi la diffusion des impuretés à l'intérieur du filtre.
- Courbe avec une courbure vers le bas (Figure 3. 5 d)
L'élimination de la turbidité est déficiente; il y a donc risque de détérioration de la qualité de l'effluent.
3.3.3.3. Optimisation de l'utilisation d'un filtre
Pour optimiser l'utilisation d'un filtre, on doit le faire fonctionner de telle sorte que, lorsque la turbidité de l'effluent atteint la valeur maximale permise, les pertes de charge atteignent, elles aussi, leurs limites maximales permises (Figure 3. 6).
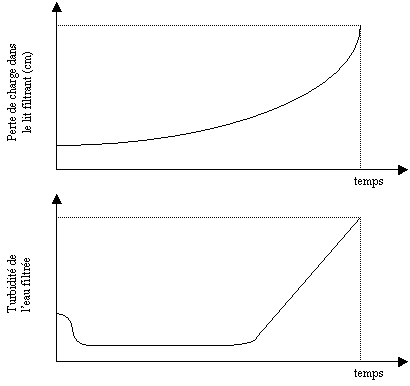
Figure 3. 6 : Variation de la perte de charge et de la turbidité en fonction du temps
L'utilisation d'un filtre n'est pas optimale lorsque les deux situations ci-dessous se produisent.
- Les pertes de charge atteignent leurs valeurs maximales alors que la turbidité est toujours faible. Pour corriger cette situation, on peut soit accroître la charge superficielle afin d'augmenter la valeur des forces de cisaillement (et permettre ainsi une meilleure pénétration du floc), soit augmenter le diamètre effectif du milieu filtrant.
- La turbidité atteint sa valeur maximale alors que les pertes de charge sont toujours faibles. Pour corriger cette situation, on peut soit réduire la charge superficielle afin de ne pas briser le floc, soit additionner un polymère destiné à renforcer le floc, soit diminuer le diamètre effectif du milieu filtrant
3.3.3.4. Lavage des filtres
Lorsque la perte de charge, la turbidité, ou les deux, atteignent leurs valeurs maximales, on lave le filtre en injectant de l'eau par le fond.
1- Mécanisme de lavage
Lorsque l'eau de lavage est injectée par le fond, le milieu filtrant prend de l'expansion et libère les particules arrêtées par le filtre. Ces particules, beaucoup moins denses que les grains de sable, sont aisément entraînées vers les goulottes de lavage. Le niveau maximal du sable en expansion atteint 8 à 30 cm au-dessus de son niveau au repos. Le degré d'expansion du milieu filtrant dépend :
- du diamètre des grains de sable ;
- de la densité des grains de sable ;
- de la charge superficielle, ou vitesse, de l'eau de lavage ;
- de la température de l'eau de lavage.
La charge superficielle la plus utilisée est de 37 m/h. Il est important de signaler que, si l'eau de lavage est injectée brusquement dans un filtre, la totalité de la couche de sable peut être soulevée au-dessus de la couche de gravier, ce qui provoque un bouillonnement pouvant entraîner le déplacement du gravier de support.
2- Mécanismes de brassage auxiliaires
La plupart des impuretés qui encrassent un filtre adhèrent aux grains de sable; elles ne sont donc pas éliminées par un simple lavage à l'eau. Pour décoller ces impuretés, il faut augmenter la turbulence dans le milieu filtrant en expansion; on favorise ainsi le frottement des grains de sable les uns contre les autres et, par conséquent, le décollement des impuretés. Or, on ne peut pas augmenter la charge superficielle au-delà d'une certaine limite; en effet, une charge superficielle trop élevée provoque une expansion excessive du milieu filtrant et, par le fait même, des pertes de sable; de plus, il faut alors utiliser des quantités plus importantes d'eau de lavage. Donc, pour augmenter la turbulence dans le milieu filtrant en expansion sans accroître la charge superficielle, on peut soit injecter de l'air, soit utiliser des agitateurs de surface.
3- Lavage à l'eau et à l'air
On injecte simultanément, par le fond du filtre, de l'air et de l'eau. L'eau entraîne les impuretés vers les goulot tes de lavage alors que l'air assure un brassage suffisant pour décoller ces impuretés. La charge superficielle (air) doit être supérieure à 5 m/h. Signalons qu'il n'est pas nécessaire que le milieu filtrant soit en expansion pour que le lavage soit efficace. Après l'arrêt des soufflantes, il faut toutefois continuer le lavage à l'eau afin d'entraîner toutes les impuretés vers les goulot tes de lavage.
Dans le cas d'un filtre au sable et à l'anthracite, il faut d'abord abaisser le niveau de l'eau jusqu'au niveau supérieur de la couche d'anthracite, puis n'injecter que de l'air, puisqu'il est impossible d'injecter de l'air quand le niveau de l'eau dans le filtre atteint les goulot tes de lavage, ou d'injecter l'eau de lavage en même temps que l'air. Dans ces deux cas, en effet, il se produit un entraînement massif de l'anthracite vers les goulot tes de lavage. Lorsque les impuretés sont décollées, on arrête la soufflante et on injecte l'eau de lavage. La vitesse de l'eau de lavage, ou charge superficielle, est alors de 37 m/h ou plus, car seule une vitesse élevée permet de chasser les impuretés vers les goulot tes et de reclasser le matériau filtrant.
4- Lavage à l'eau seule
Lorsqu'on lave un filtre rapide uniquement avec de l'eau, le brassage est assuré par des laveurs de surface, qui peuvent être soit fixes, soit rotatifs. Chaque type de laveur envoie des jets de 3 mm de diamètre faisant un angle de 15 à 30° vers le bas avec l'horizontale. La pression de ces jets, situés à 5 cm au-dessus du niveau du sable, est d'environ 515 kPa. La quantité d'eau injectée par les jets est de 80 à 160 L/m2.min-1 pour les laveurs fixes et de 20 L/m2.min-1 pour les laveurs rotatifs.
En général, on met en action les laveurs de surface avant d'injecter l'eau de lavage par le fond du filtre, car cela permet de briser la croûte d'impuretés qui s'est formée à la surface du filtre. On peut par ailleurs injecter une faible quantité d'eau de lavage avant de mettre les laveurs de surface en action afin que le milieu filtrant prenne légèrement de l'expansion.
Lors du lavage d'un filtre à multicouches (sable et anthracite), il est recommandé de donner de l'expansion au milieu filtrant jusque bien au-dessus des laveurs de surface, faute de quoi la turbulence engendrée par ces derniers entraîne des grains d'anthracite vers les goulot tes de lavage.
Lorsque le brassage du sable est insuffisant, les particules d'impuretés arrêtées à la surface du filtre ont tendance à s'agglomérer; les agglomérats ainsi formés, trop lourds pour être entraînés lors du lavage, demeurent donc à la surface du filtre. Par ailleurs, lorsque leur masse est assez importante, ils s'enfoncent dans le sable lors des lavages.
Dans un filtre à sable et anthracite, les agglomérats de boue ont tendance à s'accumuler à l'interface sable-anthracite. Pour éliminer ce problème, on peut installer des laveurs à double niveau qui envoient des jets à environ 15 cm au-dessus du sable et à 5 cm au-dessus de l'anthracite.
5- Effets de jets
Lors d'un lavage, la vitesse de l'eau à l'intérieur du milieu filtrant n'est pas uniforme. Dans certaines zones, la vitesse de l'eau vers le haut est plus élevée que la moyenne, alors qu'en d'autres zones, l'écoulement a lieu vers le bas. Des jets, ou zones de grande vitesse, sont ainsi formés même si la couche de gravier de support est bien mise en place. On observe ces jets dans tous les milieux filtrants dotés des caractéristiques suivantes:
- milieu filtrant constitué de particules fines (sable) situées au-dessus de particules plus grosses (gravier);
- charge superficielle suffisante pour fluidiser le milieu filtrant le plus fin.
L'importance des jets est fonction de la grosseur et de la masse volumique des particules du milieu filtrant. Une charge superficielle de 60 m/h ne peut pas déplacer le gravier si celui-ci n'est pas recouvert de sable. La présence du sable augmente en effet de beaucoup la mobilité du gravier. Ainsi, dans certains cas, la vitesse de l'eau dans les jets est suffisante pour déplacer des grains de gravier beaucoup plus gros que les grains de sable. La vitesse de l'eau dans un jet peut être 10 fois supérieure à la vitesse moyenne de l'eau de lavage. Dans un jet, le sable occupe 10 à 15% du volume, alors que dans la zone adjacente au jet il occupe environ 30% du volume. La différence de densité entre ces deux zones engendre la force nécessaire pour maintenir élevées les vitesses de l'eau dans les jets. La formation des jets est par ailleurs favorisée par une mauvaise distribution de l'eau de lavage. Les jets provoquent alors des déplacements latéraux de gravier, ce qui favorise les pertes de sable. Lorsque les pertes de sable sont suffisantes pour bloquer le système de drainage du filtre, les jets sont déplacés latéralement.

