L'analyse en laboratoire consiste à effectuer des essais de sédimentation
dans une colonne permettant la prise d'échantillons à des
profondeurs diverses et à des intervalles de temps déterminés.
La mesure des matières en suspension dans ces échantillons
permet de calculer le pourcentage d’élimination correspondant.
L'ensemble de ces résultats, reporté graphiquement, permet
de tracer des courbes d'iso-rendement, (Figure 1.9) servant de base au
calcul d'un bassin de sédimentation.
Il est indispensable que la
hauteur de la colonne soit la même que celle d'un décanteur
classique (3 mètres), et que son diamètre soit suffisant
pour éviter les effets de parois.
Un diamètre de 20 à 30
cm est conseillé. |
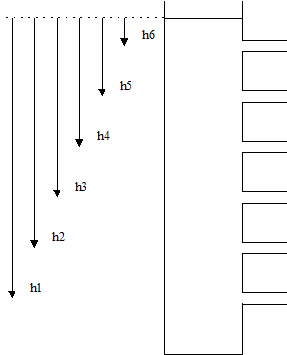
Figure 1. 8 : Colonne de laboratoire |
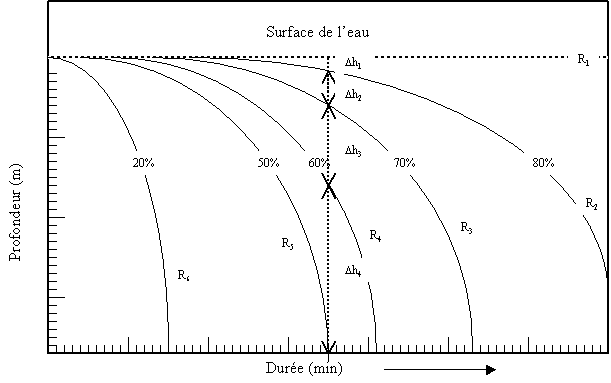
Figure 1. 9 : courbes de mêmes pourcentages d’élimination
des particules : courbes d’iso-rendement
A partir de ce genre de construction graphique, on peut évaluer le pourcentage
de particules éliminées par un bassin idéal de décantation,
en fonction de divers temps de rétention et de diverses profondeurs, à l’aide
de l’équation suivante :
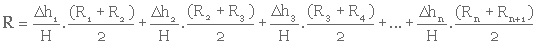 (1. 23)
(1. 23)
où
- R : pourcentage total des particules éliminées dans un bassin
de décantation idéal (rendement)
- R1, R2, …, Rn : pourcentages des particules éliminées
dans un bassin de décantation idéal, à une profondeur
h, après un temps de rétention t
- Δh1, Δh2, …., Δhn : hauteurs moyennes entre deux courbes de même
pourcentage d’élimination des particules
- H : hauteur totale de la colonne
Exemple 1. 1 :
Un essai de décantation en colonne réalisé en laboratoire
a donné les résultats présentés au Tableau 1. 1.
Quel est le pourcentage de particules éliminées dans un bassin
dont la profondeur utile est de 1,8 m et la période de rétention
de 25 min ?
Tableau 1. 1 : pourcentage de particules éliminées en fonction
du temps et de la profondeur
Temps (min) |
Profondeur (m) |
| 0,60 |
1,20 |
1,80 |
10
20
30
40
70 |
31
59
67,2
69
73 |
21,3
49
61
65
69 |
14,1
40
55,6
60,8
66,7 |
Solution
a) On trace le graphique de la variation du pourcentage de particules éliminées
en fonction de la profondeur et du temps de décantation
b) On calcule le rendement en utilisant l’équation (1. 23)
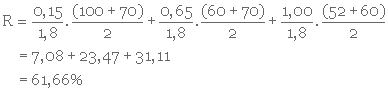
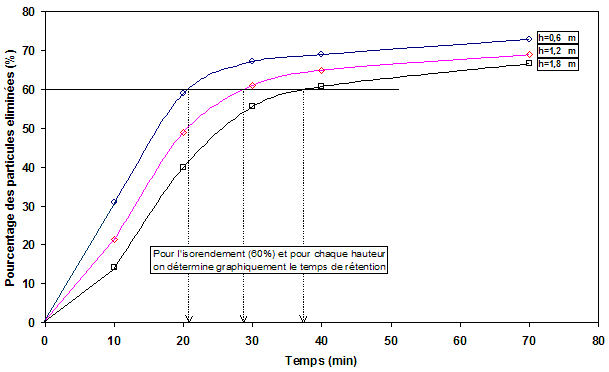
Figure 1. 10 : première étape de la construction graphique (détermination
des temps de rétention (les verticales) pour diverses iso-rendements
(les horizontales)
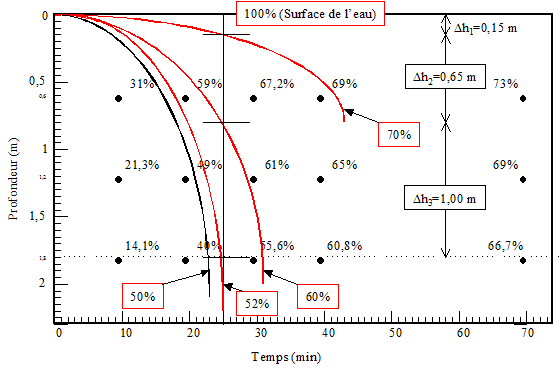
Figure 1. 11 : courbes d’iso-rendement
Exemple 1. 2 :
On soumet à un essai de décantation en colonne des eaux usées
contenant 400 mg/l de matières en suspension. A partir de l’analyse
d’échantillons prélevés à intervalles réguliers,
on obtient les résultats présentés au Tableau 1. 2.
Quelle
est la charge superficielle et le temps de rétention requis pour réduire
la concentration de matières en suspension à 150 mg/l ?
La profondeur
du décanteur est de 1,8 m. Le facteurs de sécurité applicables à la
charge superficielle et au temps de rétention sont respectivement de
1,5 et de 1,75.
Tableau 1. 2 : pourcentage des particules éliminées en fonction
du temps et de la profondeur
Temps (min) |
Profondeur (m) |
| |
0,60 |
1,20 |
1,80 |
5
10
20
40
60
90
120 |
41
50
60
67
72
73
76 |
19
33
45
58
62
70
74 |
15
31
38
54
59
63
71 |
Solution
A l’aide des résultats du Tableau 1. 2, on trace les courbes de
mêmes pourcentages d’élimination des particules (Figure 1.
13). L’objectif des 150 mg/l correspond à un rendement de 62,5%,
puisque 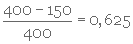 . On obtient la valeur de la charge superficielle ou du temps de rétention
en fonction du rendement (Figure 1. 14). A titre d’exemple, à un
temps de rétention de 35 min correspond une charge superficielle de
. On obtient la valeur de la charge superficielle ou du temps de rétention
en fonction du rendement (Figure 1. 14). A titre d’exemple, à un
temps de rétention de 35 min correspond une charge superficielle de  m/min ou 3,09 m/h. Le pourcentage des matières en suspension éliminés est
alors de
m/min ou 3,09 m/h. Le pourcentage des matières en suspension éliminés est
alors de
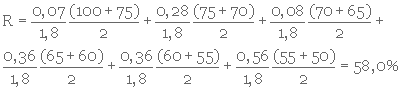
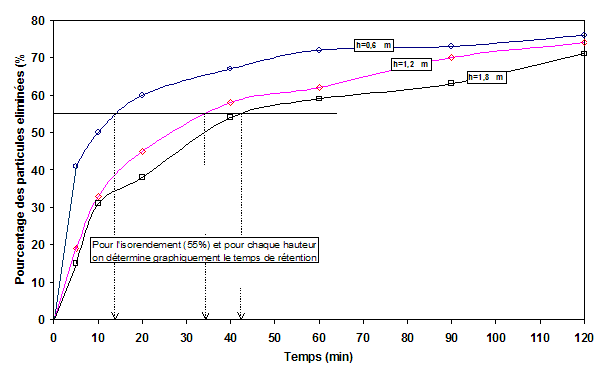
Figure 1. 12 : première étape de la construction graphique (détermination
des temps de rétention (les verticales) pour diverses iso-rendements
(les horizontales)
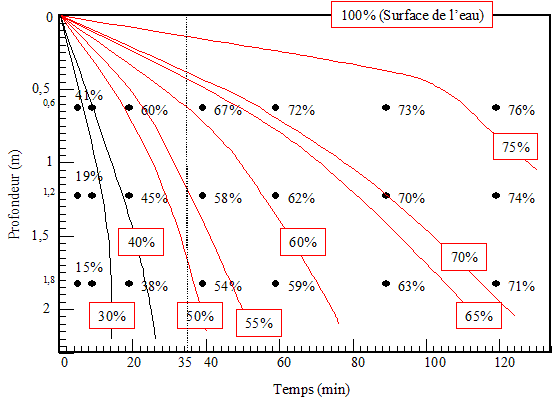
Figure 1. 13 : courbes d’isorendement
En effectuant les calculs pour des temps de rétention de 40 et 45 min,
on obtient les résultats présentés au Tableau 1. 3, à partir
des quels on trace la courbe de la Figure 1. 14. De là, on déduit
aisément qu’un rendement de 62,5% exige un temps de rétention
de 43 min, ce qui correspond à une charge superficielle de 2,5 m/h.
Le décanteur doit donc avoir un temps de rétention de 1,75*43=75
min et une charge superficielle de 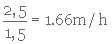 .
.
Tableau 1. 3 : charge superficielle te rendement calculés en fonction
du temps
Temps de rétention (min) |
Charge superficielle (m/h) |
Rendement (%) |
35
40
45 |
3,09
2,70
2,40 |
58,0
61,7
62,9 |
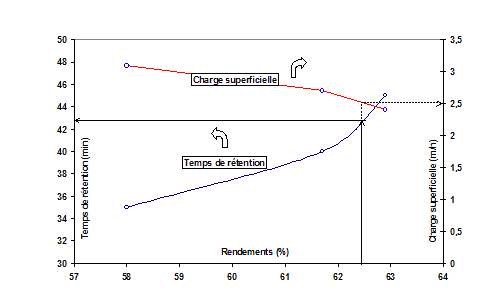
Figure 1. 14 : variation du temps de rétention et de la charge superficielle
en fonction du rendement
Décanteur à flux vertical
La démarche expérimentale est la même que précédemment.
On se reporte à un faisceau de courbes tel que celui de la figure précédente,
où il suffit de déterminer le pourcentage de matières
solides totalement éliminées, correspondant à une durée
de rétention que l'on se fixe, en interpolant si nécessaire.

