Les décanteurs à fonctionnement discontinu
Ce sont des bassins dont le remplissage se fait par intermittence; l'eau y séjournant au repos quelques heures. Le bassin est ensuite vidé par une turbulence située à un niveau supérieur à celui des boues déposées, celles-ci étant évacuées périodiquement. Ce type de décanteur ne peut convenir que pour des installations de fortune.
Les décanteurs à fonctionnement continu
Le décanteur cylindro-conique non raclé
Ce décanteur à flux vertical est utilisé pour des installations à petits débits (20 m 3 /h maximum). Il est utilisé dans le cas de traitement par voie chimique et dans la décantation primaire des eaux résiduaires de faibles débits.
Il trouve également son emploi dans des installations plus importantes, chaque fois que le volume des précipités à décanter est faible et que leur densité est élevée. |
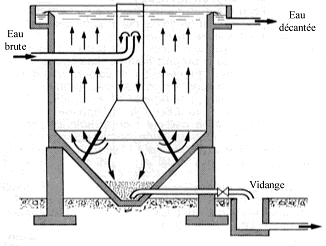
Figure 1. 15 : Schéma d'un décanteur cylindro-conique |
La pente de la partie conique de l'appareil est comprise entre 45 et 65°, suivant la nature des eaux traitées et le type de traitement appliqué (60° pour les décanteurs primaires des eaux usées domestiques). La vitesse ascensionnelle moyenne utilisée est de 1 à 2 m/h.
Le décanteur statique à raclage de boues
• De forme rectangulaire
Le décanteur longitudinal rectangulaire permet une implantation plus compacte des différentes unités de traitement.
Pour ce type d'installation, on adopte généralement un rapport longueur/largeur compris entre 3 et 6. La profondeur du bassin est comprise le plus souvent entre 2,5 et 4 m, et la pente du fond est de l'ordre de 1 %.
 Visualiser l'animation Flash Visualiser l'animation Flash
|
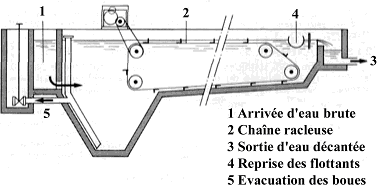
Figure 1. 16 : décanteur rectangulaire raclé
|
| 
Photo 1. 2 : Décanteur rectangulaire vide |

Photo 1. 3 : Décanteur rectangulaire plein |
Le ramassage continu des boues est assuré par deux chaînes portant des pales de raclage (ou pont racleur). Les boues sont amenées dans une fosse de laquelle elles sont soutirées automatiquement.
En surface, les pales assurent le ramassage des corps flottants, évacués ensuite par une goulotte.
Il peut arriver que la décantation soit accélérée par adjonction de réactifs chimiques adéquats. Dans ces cas l'ajout des réactifs se fait à l'admission des décanteurs.
|

Photo 1. 4 :
Lieu d'addition du floculant
|

Photo 1. 5 : Addition des réactifs de floculation |
• De forme circulaire
| Dans ce décanteur circulaire, de hauteur comprise entre 2 et 3,5 m ; le racleur est fixé à une charpente tournant autour de l'axe du bassin, avec un entraînement central ou périphérique. La pente du radier est de 8 %; le diamètre du bassin allant de 5 à 40 m.
 Visualiser l'animation Flash Visualiser l'animation Flash
|
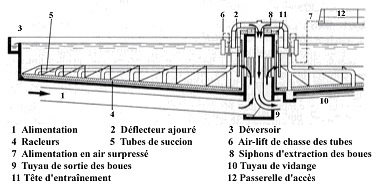
Figure 1. 17 : schéma en coupe d'un décanteur circulaire |
|

Photo 1. 6 : Décanteur primaire de forme circulaire |

Photo 1. 7 : Décanteur secondaire de forme circulaire |

Photo 1. 8 : Déversoir des eaux épurées |

Photo 1. 9 : Evacuation des matières flottantes |
Les eaux épurées sont évacuées en haut du décanteur par surverse à travers un déversoir. Les boues sont amenées dans une fosse centrale, de laquelle elles sont évacuées par un système automatique d'extraction.
Le décanteur lamellaire
Ce type d'appareil récent met à profit le fait que pour des suspensions peu concentrées, le rendement de séparation ne dépend, théoriquement, que de la surface du décanteur et de son débit et non de sa profondeur, et par conséquent de son volume. On a pu ainsi aboutir à la conception d'appareils extrêmement compacts et pouvant traiter des débits importants avec de faibles durées de rétention.
L'installation de "n" cloisons horizontales, dans un décanteur rectangulaire de surface utile S, dont l'alimentation se fait à travers toute une section verticale, réalise une surface effective de décantation de "nS". En d'autres termes, pour traiter un débit donné, le volume de ce type de décanteur est divisé par "n" par rapport à celui d'un décanteur non lamellaire qui traite le même débit.
| D'autre part, la présence de ces cloisons régularise le régime hydraulique et, en augmentant le périmètre mouillé, fait diminuer le nombre de Reynolds, ce qui favorise l'écoulement laminaire.
En pratique, il faut pouvoir éliminer la boue déposée, ce qui est impossible avec des cloisons horizontales. |
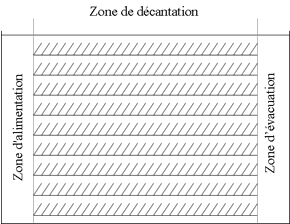
Figure 1. 18 :
Zones d'entrée, de décantation et d'évacuation dans un décanteur lamellaire |
Il faut donc incliner celles-ci. Dans ce cas, la surface effective du décanteur, comportant "n" parois inclinées d'un angle α par rapport à l'horizontale, devient nScos α. On a donc intérêt à choisir l'angle α le plus faible possible compatible avec l'évacuation des boues déposées.
|
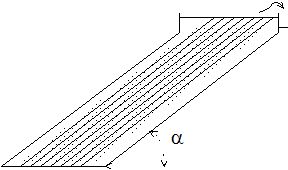
Figure 1. 19 :
décanteur lamellaire à contre-courant |
La simple modification des décanteurs classiques conduit naturellement à un système de circulation à contre-courant de l'eau et de la boue, comme le montre la figure ci-contre. La chute de la boue y est contrariée par le mouvement de l'eau, et donc l'angle d'inclinaison des parois doit être d'au moins 60°. |
Au contraire, en adoptant une circulation à co-courant, le mouvement du liquide facilite le déplacement de la boue, et on peut se contenter d'un angle α plus petit (25 à 40°), ce qui conduit à une surface effective de décantation plus grande, à volume égal.
|
La boue est entraînée vers le bas du décanteur par l'action conjuguée des forces de frottement du fluide et des forces de gravité. Grâce au fonctionnement co-courant, le système est autonettoyant.
Cet appareil convient particulièrement bien pour la séparation des précipités "floconneux", et peut admettre des charges superficielles allant jusqu'à 50 m 3 par m 2 de surface au sol et par heure. |
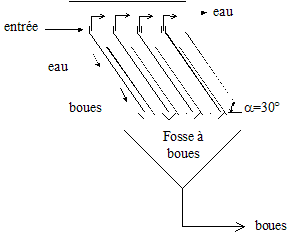
Figure 1. 20 : décanteur lamellaire à co-courant |
Le Tableau 1. 4 ci-dessous nous montre la surface utile de décantation par m3 d'appareil, en fonction du type d'installation.
Tableau 1. 4 : surface utile de décantation par type d'installation
Type d'installation |
Surface de décantation par m3 de décanteur |
Bassin conventionnel |
0,25 à 0,50 m2 |
Séparateur à cloisons, circulation à contre-courant |
8 à 10 m2 |
Séparateur à cloisons, circulation à co-courant |
22 à 26 m2 |

